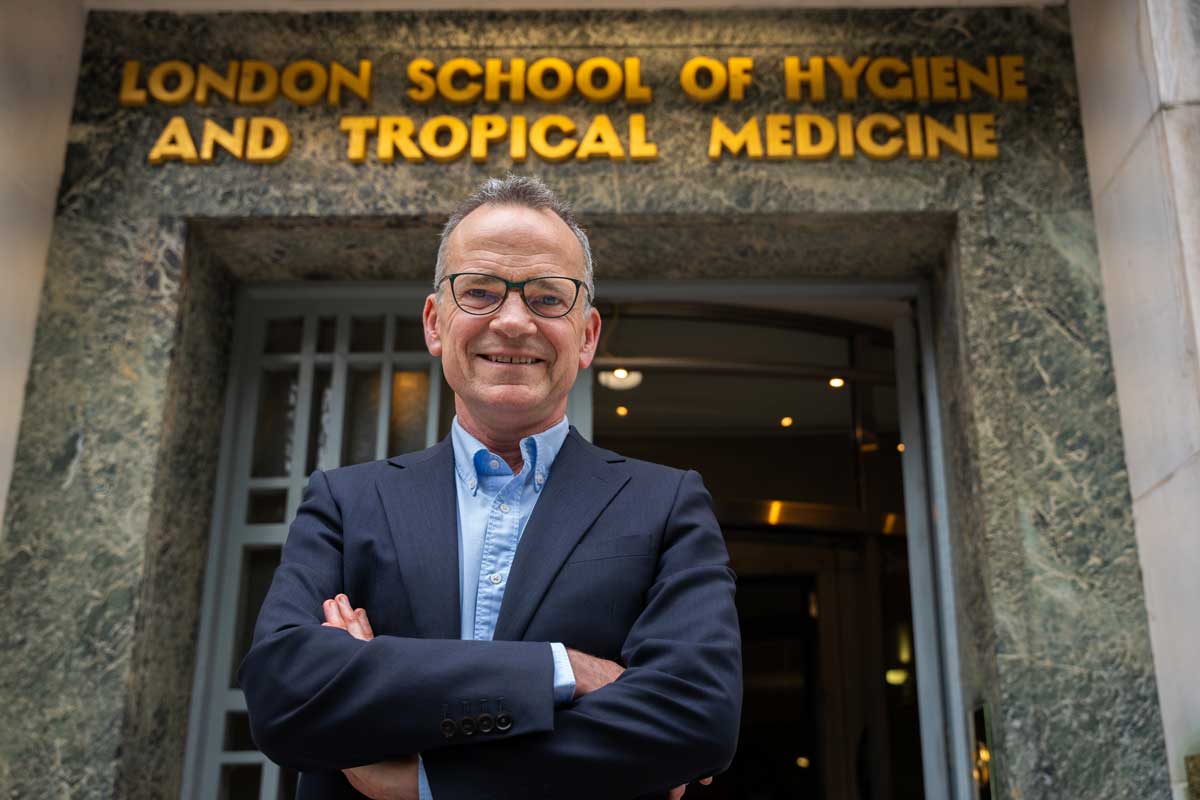Les spécialistes du paludisme appellent à l’action face à la résistance croissante aux médicaments en Afrique
Les schémas de résistance à l’artémisinine observés en Asie du Sud-Est sont désormais découverts en Afrique, ce qui menace de créer une « bombe à retardement » des décès dus au paludisme.
- 17 mai 2024
- 4 min de lecture
- par Priya Joi

À mesure que les données probantes relatives à la résistance croissante aux médicaments antipaludiques s’accumulent dans toute l’Afrique, les spécialistes du paludisme appellent à une action urgente pour protéger cette ligne de défense essentielle.
La résistance aux médicaments, largement répandue en Asie du Sud-Est, s’accroît depuis des années et a d’ores et déjà entraîné une augmentation du nombre d’infections et de décès dans la région. Les scientifiques avaient décrit la résistance aux médicaments contre le paludisme comme une « bombe à retardement » qui exploserait si elle venait à atteindre l’Afrique, dans la mesure où le continent compte 94 % des 249 millions de cas recensés dans le monde.
Bien qu’il existe aujourd’hui des vaccins contre le paludisme, ils sont plus efficaces pour sauver des vies lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec des traitements antipaludiques efficaces.
Mais la mèche semble avoir été allumée. Des résistances apparaissent sur tout le continent et les spécialistes préviennent que l’objectif visant à éliminer le paludisme à l’échelle mondiale paraît de plus en plus menacé.
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine ont joué un rôle essentiel dans le traitement des infections paludéennes causées par le parasite Plasmodium falciparum, l’artésunate par voie intraveineuse constituant un traitement important pour les formes graves de paludisme. Plusieurs pays d’Afrique de l’Est, parmi lesquels l’Érythrée, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda, ont signalé une résistance partielle à l’artémisinine (ART-R), ce qui met en péril ces traitements antipaludiques vitaux.
Bien qu’il existe aujourd’hui des vaccins contre le paludisme, ils sont plus efficaces pour sauver des vies lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec des traitements antipaludiques efficaces.
Des scientifiques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et d’institutions en Afrique (Cameroun, Éthiopie, Tanzanie, Mali, Namibie, Ouganda et Afrique du Sud) ont lancé un appel urgent à l’action dans la revue scientifique Nature Medicine aujourd’hui, lors de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.
La résistance à l’artémisinine, principalement médiée par des mutations de la protéine Kelch13 (K13) du parasite P. falciparum, entraîne un retard dans la clairance parasitaire. Cela pose problème. En effet, la non-élimination du parasite du système sanguin dans un délai de deux jours peut entraîner l’échec du traitement et renforcer la résistance aux médicaments.
Pour aller plus loin
En Afrique, des mutations associées à la résistance à l’artémisinine ont été confirmées dans plusieurs pays, ce qui indique des origines diverses des parasites résistants et souligne la nécessité de mesures globales d’endiguement et de contrôle.
Les chercheurs estiment que la création d’organisations telles que l’Initiative régionale de lutte contre la résistance à l’artémisinine (RAI, pour Regional Artemisinin-resistance Initiative) et le Réseau Asie-Pacifique d’élimination du paludisme (APMEN, pour Asia Pacific Malaria Elimination Network) est une bonne chose, ainsi que le lancement par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’une stratégie visant à atténuer la résistance à l’artémisinine en Afrique.
Toutefois, à leur dire, l’action politique a été insuffisante et les engagements financiers se sont révélés trop peu nombreux pour que de réels progrès puissent être accomplis concernant l’arrêt de la propagation de la résistance aux médicaments antipaludiques dans toute l’Afrique.
Ils appellent notamment les gouvernements des zones à risque confrontées à la résistance à reconnaître l’urgence de la situation et à convenir d’actions coordonnées, telles que la mise à jour des directives relatives aux traitements sur la base des schémas de résistance émergents. Les mécanismes de coordination régionale, avec un partage rapide des données, des connaissances et des expériences normalisées et validées, seront essentiels, ajoutent-ils.
Ils souhaitent également une meilleure surveillance de la maladie grâce à des plateformes génomiques, des études d’efficacité thérapeutique et des analyses phénotypiques des parasites afin de « surveiller la propagation des parasites résistants et d’évaluer l’impact des efforts d’atténuation des effets du paludisme. »
Cette démarche peut s’appuyer sur l’expansion des capacités des laboratoires en Afrique, qui a été largement stimulée par la pandémie de COVID-19. Cela requiert toutefois des réactifs et des équipements, des normes et des processus pour la production et le partage des données, ainsi que le développement d’une capacité à traduire les données moléculaires, cliniques et parasitologiques en décisions politiques.
L’Afrique subsaharienne nécessite une approche sur mesure qui ne saurait être calquée sur celle issue d’autres régions du monde. Ils préconisent des interventions multiples, notamment le contrôle des vecteurs, la gestion des cas, la chimioprévention, la vaccination et la communication à propos des changements sociaux et comportementaux.
Les interventions prioritaires peuvent inclure le déploiement sur mesure de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine triples ou séquentielles ou de plusieurs thérapies de première ligne, précisent-ils. L’ajout de médicaments bloquant la transmission, tels que la primaquine à faible dose unique, peut contribuer à réduire la propagation de la résistance partielle à l’artémisinine.
Enfin, ils appellent à des recherches plus poussées afin d'identifier les « médiateurs de la résistance du parasite P. falciparum aux médicaments partenaires ». Des rapports récents laissent entendre que des parasites moins sensibles à la luméfantrine circulent déjà en Ouganda, où des mutations de la protéine K13 sont désormais présentes.
« Une collaboration nationale et régionale accrue entre les secteurs de la recherche, de la santé et d’autres secteurs pertinents nécessite un soutien programmatique pour accélérer l’identification des facteurs de résistance et atténuer leur impact », déclarent les scientifiques.
Davantage de Priya Joi
Recommandé pour vous