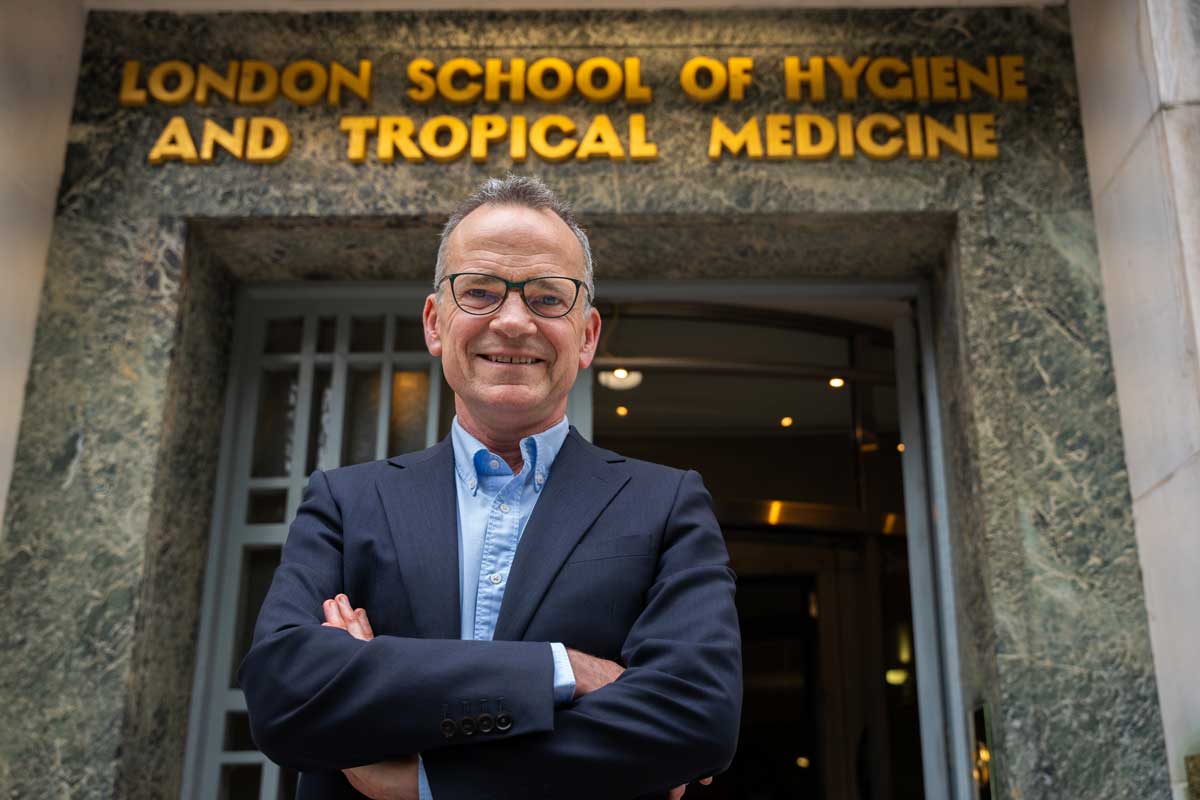A Madagascar, l’épidémie de peste s’enflamme avec la multiplication des feux de brousse
Madagascar brûle. Plus d’un millier de points de feu s’y déclarent chaque jour, surtout depuis septembre. Le fléau qui devient un cauchemar pour la population coïncide avec le début de la saison de la peste sur l’île où cette maladie vectorielle tue des dizaines de personnes tous les ans. A cause de l’ampleur des incendies, une épidémie est à craindre cette année.
- 8 novembre 2022
- 5 min de lecture
- par Rivonala Razafison

Plus de feux à cause du réchauffement climatique
Le ministère malgache de la Santé publique redouble de vigilance. La conséquence probable de la multiplication des feux de brousse et de forêt sur la santé humaine inquiète. Toutes les régions sont affectées en cette saison sèche ayant démarré en août-septembre, qui est aussi le début de la saison pesteuse au pays.
Les incendies gagnent davantage de terrain sous l’effet de la forte chaleur en lien avec le réchauffement planétaire. Plus de 3600 points de feu étaient par exemple détectés dans la seule journée du 12 octobre. La prise de mesures d’urgence du gouvernement a fait baisser les nombres journaliers. Mais les dégâts subséquents sont importants.
Les incendies auraient détruit environ 700 000 hectares de terres et de forêt jusqu’au 25 octobre où 1717 foyers étaient répertoriés. Selon le ministère de l’Environnement et du Développement durable, plus de la moitié du réseau national d’aires protégées, totalisant plus de 7 millions d’hectares, est touchée.
Les feux poussent naturellement certains animaux, y compris les petits mammifères – réservoirs par excellence d’Yersinia pestis, l’agent pathogène responsable de la peste – à se réfugier ailleurs en migrant massivement vers des zones habitées où ils trouvent aussi de la nourriture.
Sur la base des informations fournies par le ministère, la presse locale renseigne aux alentours de la mi-octobre sur la résurgence de la zoonose bactérienne transmise à l’humain par les puces. Les feux liés aux problèmes d’origine environnementale sont mis sur le banc des accusés.
Pour aller plus loin
Le professeur Fidiniaina Mamy Randriantsarafara, directeur général de la Médecine préventive, rassure quand même. « La saison pesteuse à Madagascar va de septembre/octobre à mars/avril. Des cas sont signalés dans 29 districts. Une légère hausse par rapport à l’année précédente est notée. Mais elle n’est pas encore scientifiquement significative », souligne le haut responsable étatique.
Suivant les données officielles, le pays a enregistré 200 cas suspects et confirmés depuis septembre et 161 depuis janvier. Dans la même foulée, 306 cas dont 139 confirmés ont été rapportés entre le 1er août 2021 et le 25 octobre dernier. Parmi les cas confirmés, 111 sont déclarés de la peste bubonique et 28 de la peste pulmonaire. Les deux types confondus ont emporté 32 vies humaines durant la même période.
Les feux poussent naturellement certains animaux, y compris les petits mammifères – réservoirs par excellence d’Yersinia pestis, l’agent pathogène responsable de la peste – à se réfugier ailleurs en migrant massivement vers des zones habitées où ils trouvent aussi de la nourriture.
Tous les foyers actifs sont placés sous haute surveillance. « Nous y avons prépositionné les médicaments nécessaires à la prise en charge des pestiférés et les produits requis pour lutter contre les rongeurs et les puces », affirme Pr Randriantsarafara.
Campagnes de sensibilisation
Le but étant de sauver la vie des malades, la campagne de sensibilisation bat son plein dans les districts concernés. « Les habitants sont invités à se rendre rapidement au centre de santé le plus proche aux moindres signes. Un traitement spécifique existe depuis 2019 où le protocole a été amélioré », dit la source autorisée. Savoir qu’il faut rester extrêmement vigilant peut sauver des vies.
En une semaine de novembre 2020, quatre membres d’une même famille sont décédés à Sahamarolambo, une localité en pleine forêt dans la commune rurale de Morarano Gara, Moramanga. « Vers 10 heures du matin, notre mère se plaignait des maux de tête. Nous pensions qu’il s’agissait d’une maladie sans gravité. Notre parent mourrait le lendemain matin. C’était rapide », témoigne Jean Marcel Rakotondrasitraka, 31 ans, le deuxième enfant de la victime.
L’étrange maladie qui n’a jamais été connue dans la localité a d’abord emporté la petite nièce du témoin en infectant d’autres membres de la famille. « Ma femme était aussi affectée. Mais elle était guérie après avoir été rapidement transportée au centre de santé. Outre notre mère et sa petite fille, notre beau-frère et une de nos tantes sont également décédés. Nous n’avions jamais été en face d’une tragédie pareille », ajoute-t-il. La zone d’habitation et les champs tout autour sont infestés de rats, reconnaît-t-il.
Selon ses dires, les corps des malades présentaient tous des ganglions et un liquide blanchâtre sortait de la bouche et des narines après leur décès. Ils ont été enterrés dans des caniveaux en dehors de la tombe familiale sur ordre formel des autorités locales et médicales. Mais un hiatus jette tout le monde dans le désarroi. « Nous avons bel et bien traité des pestiférés. Le résultat du test diagnostic rapide (TDR) était positif. Par contre, celui du test PCR effectué par l’Institut Pasteur était négatif », soulève un membre du personnel du centre de santé de base de Morarano Gare.
De l’avis du Pr Randriantsarafara, plusieurs paramètres peuvent entrer en jeu pour expliquer la différence entre le résultat du TDR et celui du PCR. « Le résultat du TDR doit être soumis au test PCR, le gold standard. Nous avons besoin de confirmation bactériologique. Quoi qu’il en soit, tous les cas, suspects ou non, font toujours l’objet d’investigation systématique », observe-t-il.
Pour la situation actuelle, il prévient que le pays n’est qu’au début de la saison pesteuse. Du côté des prévisions météo, la présente saison sèche pourrait s’allonger jusqu’en janvier pour certaines régions.
Suivez l'auteur sur Twitter : @rivonala77
Davantage de Rivonala Razafison
Recommandé pour vous