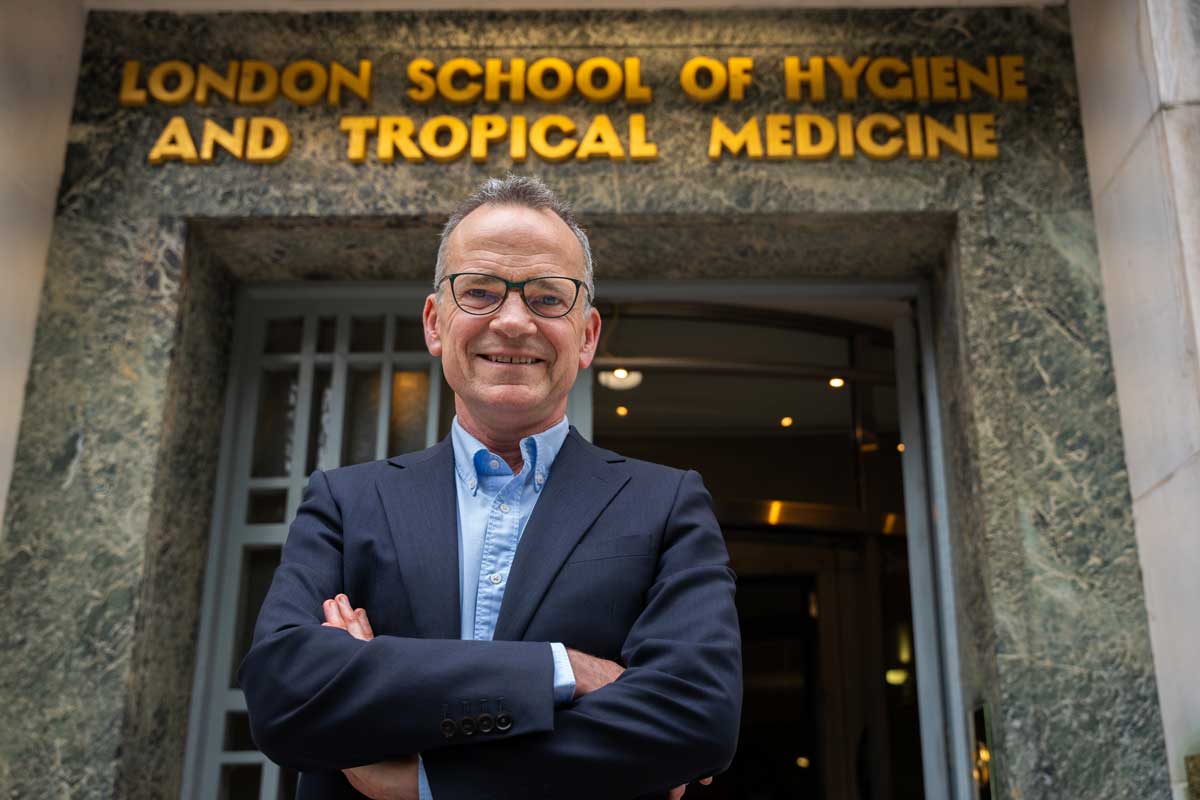En Zambie, chefs religieux et travailleur·ses du sexe unissent leurs forces contre la stigmatisation liée au mpox
Les souvenirs de la crise du sida dans les années 1990, au cours de laquelle les malades étaient rejetés et des groupes entiers de la société désignés comme boucs émissaires, alimentent aujourd’hui une campagne de démystification menée par un pasteur à Lusaka.
- 27 janvier 2025
- 8 min de lecture
- par Tsitsi Bhobo

Le pasteur Bingu Musonza, dirigeant d’une église à Lusaka, penche la tête sur le côté, grattant distraitement les pages de sa Bible, tandis qu’il se remémore une époque plus sombre.
Il pense aux années 1990 : le VIH ravageait la Zambie et, dans son sillage, tel un second fléau, une vague de stigmatisation sociale cruelle s’est abattue.
Bien que la science sur la transmission du VIH ait clairement montré qu’il n’y avait aucun danger, certains de ses coreligionnaires refusaient d’assister à des cérémonies de baptême utilisant les mêmes bassins d’eau que ceux qui avaient servi à oindre des malades du sida, se souvient le pasteur Musonza, ou s’abstenaient de partager la sainte cène avec des personnes diagnostiquées séropositives.
« Quand j’ai entendu parler de ce nouveau mpox, j’ai craint que la stigmatisation ne réapparaisse, et nous avons cherché à agir vite, de manière proactive », dit-il. Par « nouveau mpox », il fait référence au variant Clade 1, une souche du virus qui a commencé à se propager à une vitesse sans précédent en 2024, rendant des dizaines de milliers de personnes malades et en tuant des centaines dans la République démocratique du Congo voisine.
En août, une flambée de grande ampleur dans la région et au-delà a poussé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer le mpox urgence de santé publique de portée internationale. Fait notable, plusieurs rapports indiquent que, dans de nombreux cas, la propagation du mpox Clade 1 était, comme le VIH, favorisée par des contacts sexuels.
« Nous avons tiré les leçons de l’époque du sida. Si nous n’agissons pas pour enrayer les rumeurs et la stigmatisation, la fréquentation de l’église et l’unité de la société en souffriront. »
- Pasteur Bingu Musonza
À ce jour, cependant, la Zambie n’a confirmé que deux cas de mpox. Pourtant, ce faible nombre de cas n’a pas empêché la désinformation de se propager dans les groupes WhatsApp, où foisonnent de fausses affirmations faisant état d’une transmission généralisée du mpox.
Dans ce que l’homme d’Église qualifie d’« hystérie sans fondement », certains fidèles de son église, la Zion Christian Church dans la capitale malawite, ont évité les offices du dimanche, invoquant la crainte d’être infectés. « C’est déconcertant, mais cette fois, nous sommes prêts à lutter contre la stigmatisation au sein des populations vulnérables », dit-il.
Amen !
Partout en Zambie, explique-t-il, des responsables chrétiens se sont unis spontanément et de manière informelle pour contrer une campagne de désinformation qui attise les craintes liées au mpox.
Leurs méthodes varient : les groupes WhatsApp et les offices religieux constituent des canaux de communication courants – et peut-être évidents – mais il en existe d’autres. « J’ai entendu dire qu’à la frontière de Solwezi, à 580 kilomètres d’ici, à Lusaka, trois pasteurs à la retraite se portent également volontaires pour parler dans les gares routières et sur les marchés publics, afin d’encourager la population à ne pas discriminer les réfugiés congolais », raconte Musonza.
Rien qu’à Lusaka, Musonza fait partie d’un groupe de dix pasteurs de différentes confessions qui ont décidé de contrer ces rumeurs, dans l’espoir d’endiguer la montée des préjugés qu’ils redoutent.
Ces hommes d’Église forment les administrateurs des groupes WhatsApp de l’église à bloquer ou supprimer les faux messages viraux et les images alarmistes de patients atteints de mpox. Lors de réunions entre pasteurs, ils discutent de la nécessité de faire passer certains messages : le mpox n’est pas véhiculée par les réfugiés congolais, répètent-ils à leurs communautés. Elle ne « vit » pas dans les maisons closes et ne concerne pas un groupe ethnique en particulier. Le ministère de la Santé zambien et l’OMS constituent les seules sources légitimes de données actuelles sur la maladie.
« Nous avons tiré les leçons de l’époque du sida. Si nous n’agissons pas pour enrayer les rumeurs et la stigmatisation, la fréquentation de l’église et l’unité de la société en souffriront », déclare Musonza. Pour lui, c’est aussi un combat très personnel : il a vu deux membres de sa famille proche succomber au sida à la fin des années 1990, rejetés par leurs proches.
Des convertis
Les efforts menés par l’Église pour contrer la désinformation sur le mpox portent leurs fruits à l’échelle locale, affirme Willard Nakala, évangéliste au sein de l’Apostolic Faith Mission Church à Lusaka et collaborateur du pasteur Musonza.
Il sort son smartphone et l’agite pour illustrer ses propos : tout membre de son groupe d’église qui ose créer ou transférer des images truquées de Zambiens prétendument atteints de mpox est vite réprimandé par les autres membres du groupe WhatsApp lié à l’église. Et s’ils n’en tiennent pas compte, ajoute-t-il, ils sont exclus de tous les groupes WhatsApp de l’Église.
Selon Nakala, des mesures radicales sont parfois nécessaires, car la stigmatisation peut s’emballer très vite. Au plus fort de l’ère du sida, les travailleuses et travailleurs du sexe étaient plus stigmatisé·es que quiconque. Aujourd’hui encore, on entend dire à tort qu’ils et elles sont les principaux responsables de la transmission du VIH en Zambie – une idée qui persiste malgré les données sérologiques démontrant que l’infection peut se transmettre de multiples manières, explique-t-il.
Âgée de 29 ans, trop jeune pour se souvenir de la crise du VIH dans les années 1990, Shylet Sozwana est cheffe de chœur dans l’église du pasteur Musonza. Elle confie que la campagne de démystification lancée par les chefs religieux a profondément changé sa vision de la maladie, de la culpabilité et de la stigmatisation en général. Elle a grandi dans ce qu’elle décrit comme une famille religieuse ultra-moraliste, où l’on attribuait systématiquement des maladies comme le VIH et Ebola à certains groupes sociaux.
« Auparavant, je faisais partie de celles et ceux qui transféraient, dans nos groupes WhatsApp, des images mensongères sur de soi-disant cas de mpox en Zambie. J’ai été publiquement réprimandée, corrigée, et destituée de ma fonction d’administratrice de groupe. J’ai réappris les faits et j’ai fini par sensibiliser mes parents, mes frères, mes sœurs et mes proches – via ce même WhatsApp – à la nécessité de consulter les sites de l’OMS et du ministère de la Santé avant de relayer la moindre rumeur idiote », raconte-t-elle.
Les travailleur·ses du sexe – encore désigné·es comme boucs émissaires ?
Avec la montée en flèche des cas associés au Clade I et les gros titres rapportant que le mpox peut se transmettre sexuellement, les travailleur·ses du sexe risquent une fois de plus d’être blâmé·es pour un virus qui peut toucher tout le monde.
Des religieux, dont le pasteur Musonza, ont tendu la main aux travailleur·ses des bordels informels – et, strictement parlant, illégaux – de Lusaka pour démystifier les mythes et partager les faits.
« Nous n’aurions jamais imaginé que les pasteurs viendraient à nous, s’assiéraient avec nous et nous demanderaient de mettre des affiches sur le mpox dans les couloirs de nos bordels », confie Ndoda Phiri*, propriétaire d’un bar populaire et d’un bordel dans le quartier défavorisé de Garden Chilulu, où la pauvreté est omniprésente et les opportunités rares.
Il déploie une affiche imprimée sur le mur de la salle des réservations du bordel. On peut y lire : « Adoptez une bonne hygiène, désinfectez vos mains, le mpox n’est pas une maladie de réfugiés ou de travailleur·ses du sexe, traitez tous les clients avec respect. Et enfin, portez un préservatif. »
Les chercheurs de la Fondation Scelles, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle, estimaient en 2019 qu’il y avait 9 285 personnes impliquées dans la prostitution de rue en Zambie. Les réfugié·es et migrant·es sans papiers venant du Congo, du Malawi et du Zimbabwe représentent une proportion significative de cette population.
« Lorsque les fausses rumeurs d’une pandémie de mpox en Zambie ont commencé en août, j’ai constaté une forte baisse du nombre de clients fréquentant les bordels de nos quartiers », raconte Phiri.
Lorsque les responsables religieux ont proposé d’intensifier leur campagne contre la désinformation, les bordels locaux du quartier de Garden Chilulu ont sauté sur l’occasion, explique Phiri. Dans son réseau de propriétaires de bordels, tous ont accepté d’afficher des posters rappelant les faits.
« Auparavant, je faisais partie de celles et ceux qui transféraient, dans nos groupes WhatsApp, des images mensongères sur de soi-disant cas de mpox en Zambie. J’ai été publiquement réprimandée, corrigée, et destituée de ma fonction d’administratrice de groupe. J’ai réappris les faits et j’ai fini par sensibiliser mes parents, mes frères, mes sœurs et mes proches à la nécessité de consulter les sites de l’OMS et du ministère de la Santé avant de relayer la moindre rumeur idiote. »
- Shylet Sozwana, 29 ans, fidèle de l'église
Les bordels représentent une économie souterraine à Lusaka, et sont essentiels à la survie de nombreuses femmes et de nombreux hommes, explique Ratidzo, une travailleuse du sexe expérimentée dans le quartier Garden Chilulu, qui préfère taire son nom de famille de peur d’être mise au ban. Pour les 30 femmes qui travaillent dans son établissement, ce n’est pas un métier particulièrement plaisant, dit-elle : les hommes peuvent arriver ivres, se montrer agressifs ou ne pas payer correctement. « Mais le travail du sexe, c’est de l’argent – pour les frais de scolarité de mes enfants, mes médicaments contre l’hypertension, la nourriture familiale en période de sécheresse. Si les hommes ne viennent pas au bordel, nos vies sont ruinées. C’est ainsi que ça se passe », explique-t-elle en s’enveloppant dans un pagne et en balayant les chambres où les clients sont reçus – l’une des tâches supplémentaires qu’elle a endossées pour gagner un peu plus d’argent.
« Je suis immigrée et je sais à quel point la stigmatisation infondée liée au mpox peut nous nuire, à nous, les femmes », confie Tanya, une travailleuse du sexe immigrée du Zimbabwe, qui collabore avec Ratidzo. Elle précise qu’elle n’est pas seulement prostituée, mais aussi commerçante : elle passe la frontière entre le Zimbabwe et Lusaka pour acheter des chaussures d’occasion qu’elle revend ensuite chez elle. Malheureusement, les chaussures ne rapportent pas assez. Mère célibataire, elle complète donc ses revenus en travaillant au bordel. Elle redoute que, si les habitués comme Israel Achimwene cessent de venir par peur du virus, son budget en pâtisse.
« Mais le travail du sexe, c’est de l’argent – pour les frais de scolarité de mes enfants, mes médicaments contre l’hypertension, la nourriture familiale en période de sécheresse. Si les hommes ne viennent pas au bordel, nos vies sont ruinées. C’est ainsi que ça se passe. »
- Ratidzo, travailleuse du sexe, préoccupée par la baisse de clientèle suite à la peur liée au mpox
« J’ai hésité à me rendre au bordel du quartier », raconte Achimwene*, un professeur de lycée veuf vivant à Garden Chilulu. C’était en août, explique-t-il : de fausses rumeurs au sujet d’une infection incontrôlable circulaient alors sur les canaux WhatsApp en Zambie. Mais en novembre, il a vu apparaître des affiches rappelant les faits réels. Il dit avoir relativisé ses craintes et prendre désormais les précautions d’hygiène habituelles, comme il le fait déjà pour le VIH ou d’autres IST.
Pour aller plus loin
Les communautés locales en première ligne
« D’ordinaire, lorsqu’une épidémie survient, on attend que de grandes ONG internationales, riches, se chargent de tout, mais [cette fois] les communautés locales se mobilisent en première ligne pour éviter que le mpox ne provoque une vague de stigmatisation semblable à celle de l’ère sida », observe Mwansa Mbulakulima, ancien député zambien et militant pour la prévention du VIH.
De leur côté, les autorités zambiennes assurent avoir « intensifié » les efforts pour endiguer l’infection. Avec des cas signalés dans les pays voisins, la Zambie court un « risque élevé » d’« importer la maladie », avait déclaré le ministre de la Santé, Elijah Muchima, à Xinhua, l’agence de presse d’État chinoise, en septembre.
Dans tout le pays, 200 agents de santé ont été formés à la gestion des éventuels cas de mpox. Des kits de dépistage ont été commandés pour la surveillance clinique, des points de contrôle sont en cours d’installation aux frontières terrestres et dans les aéroports, et une campagne d’information publique sera bientôt lancée, a-t-il promis.
À Garden Chilulu, toutefois, les habitants ont appris à compter sur les pasteurs. « Nous n’avons pas encore vu ces fameuses séances d’information publique dans notre quartier », affirme Phiri. « Notre communauté attendra l’action du gouvernement. »
*Nom modifié pour préserver l’anonymat.
Davantage de Tsitsi Bhobo
Recommandé pour vous