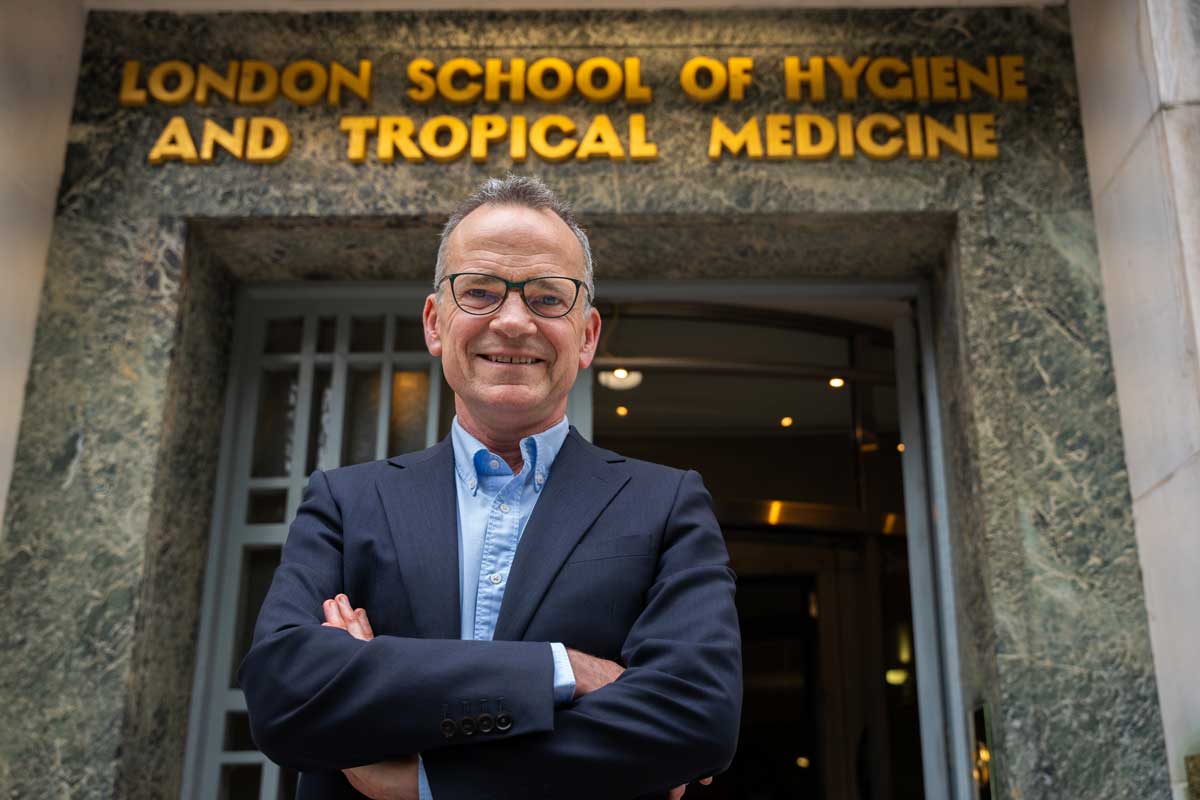« Radio Polio » : comment la radio libre au Mozambique aide à protéger les enfants
À Matola, Winile Ximba a découvert comment des voix familières, parlant les langues locales, font passer le message de la vaccination.
- 13 février 2025
- 7 min de lecture
- par Winile Ximba

« Nous aimons entendre la voix de la polio à la radio, elle nous rappelle ses ravages et l’efficacité du vaccin », confie Chido Dliwayo, 39 ans, vendeuse de fruits de rue et mère de quatre enfants à Matola.
Matola est l’un des quartiers les plus peuplés et les plus défavorisés de la banlieue ouest de Maputo, la capitale du Mozambique – un environnement où les maladies peuvent se propager rapidement lorsqu’elles ne sont pas contrôlées.
En rinçant ses mangues bien mûres, Dliwayo parle avec fierté de la carte de vaccination de son plus jeune enfant, parfaitement à jour. Pendant son enfance, la guerre civile qui a ravagé le Mozambique jusqu’en 1992 a gravement perturbé les campagnes de vaccination à travers le pays.
Privés du vaccin contre la polio, certains de ses amis ont grandi avec des membres atrophiés et des dos voûtés. Faute de moyens pour s’acheter un fauteuil roulant, beaucoup ont dû apprendre à marcher avec des béquilles en bois. Dliwayo, elle, a eu plus de chance : ses parents ont réussi à la faire vacciner grâce aux cliniques mobiles tenues par des missionnaires jésuites.
« Mes parents racontaient que certains enfants de mon âge, faute de vaccin, n’avaient pas survécu à la polio. Je me suis juré que jamais aucun de mes enfants ne manquerait une seule dose », affirme-t-elle.
Une menace persistante
En 1992, la guerre prit fin, l’accès aux soins s’élargit, et la polio sembla reculer.
Mais comme de nombreux autres virus, la polio n’a besoin que d’une brèche pour ressurgir. Après la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une chute drastique des taux de vaccination dans le monde, l'Afrique australe a été confrontée à un retour soudain de cette maladie paralysante.
En février 2022, un cas de poliovirus sauvage – dont l’analyse génétique a révélé qu’il avait été importé du Pakistan, l’un des deux derniers pays où la maladie reste endémique – a été confirmé chez une fillette de trois ans à Lilongwe, au Malawi.
Le Mozambique, pays voisin, s’est immédiatement mis en état d’alerte. Dès le mois de mai, un premier cas de paralysie flasque aiguë causée par le poliovirus sauvage a été détecté dans la province septentrionale de Tete, riche en charbon. À la fin de l’année, huit enfants mozambicains avaient été frappés de paralysie due à la souche sauvage du virus, et 26 autres avaient été affectés par des variants du poliovirus.
Grâce aux vastes campagnes de vaccination déployées par le ministère de la Santé, avec le soutien de partenaires internationaux comme l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio – une alliance d’institutions comprenant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, Gavi et d’autres acteurs – l’épidémie a pu être maîtrisée.
Mais la leçon pour les systèmes de santé de la région est sans appel : tant que la polio subsiste quelque part dans le monde, toute communauté dont le filet de protection immunitaire s’est affaibli reste exposée à une résurgence de la maladie.

Radio et vaccination
Pour protéger les enfants mozambicains, un réseau de radios communautaires financées par l’État s’efforce de convaincre les parents de l’importance de la vaccination.
Au cœur de cet effort, l’Institut de Communication Sociale (ICS), rattaché à la Radio et Télévision Éducatives Nationales du Mozambique, joue un rôle clé.
L’ICS gère un vaste réseau de stations de radio à travers le pays. En diffusant des programmes dans les langues locales comme le Ndau, le XiTsonga et le Sena, il permet de transmettre des informations précises sur les vaccins contre la polio.
« Ce n’est pas seulement un travail de diffusion pour nous, c’est une question de survie », explique Fainos de Souza, responsable de l’évaluation des impacts à l’ICS.
« La flambée épidémique de Tete nous a rappelé brutalement que la lutte contre la polio n’est jamais terminée », déclare Jengu Sithole, superviseur adjoint de la santé publique pour la municipalité de Tete. Chargé de coordonner toutes les deux semaines des émissions de sensibilisation avec les radios locales, il se souvient avoir rencontré les animateurs de Radio Moçambique, la station publique, pour lancer une campagne encourageant les mères dont les enfants avaient manqué une dose de vaccin à se rendre sans tarder dans les centres de santé.
Les animateurs se sont rapidement mobilisés sur les ondes, appelant les parents à garder leur calme mais à agir vite.
« Les parents, les agents de santé, toute la communauté… nous sommes tous devenus de grands adeptes de ces émissions de radio », affirme Sithole.
« La dame de la radio polio »
Sheila Mahoze est animatrice à temps partiel sur Radio Miramar, une station privée de Maputo. Sa passion pour les sujets de santé et son engagement à inclure au moins une émission hebdomadaire sur la vaccination contre la polio lui ont valu la confiance de sa communauté.
« Chaque fois que je marche à Matola, où je suis née, des mères viennent me saluer et disent en riant : “Voilà la dame de la radio polio !” », raconte-t-elle en ajustant ses notes avant son entrée en studio.
La sensibilisation à la polio via la radio est particulièrement efficace au Mozambique, où les stations en accès libre couvrent de vastes distances et atteignent des millions de personnes. Pour maximiser l’impact, Sheila Mahoze et ses collègues animateurs veillent à ce que les messages sur la vaccination et la santé soient d’abord diffusés en langues locales comme le Xitsonga, accordant la priorité aux langues vernaculaires plutôt qu’au portugais.
« Nous ne commettons pas l’erreur de laisser de côté les populations rurales pauvres qui ne maîtrisent pas bien le portugais », souligne-t-elle.
Gire Mafanisana, une mère de deux enfants vivant à Matola, affirme que les émissions de radio ont eu un impact décisif sur sa famille.
Après la naissance de son fils, la pauvreté et les migrations répétées causées par des inondations successives ont failli l’empêcher de le faire vacciner à temps.
En 2020, lorsque l’enfant est tombé gravement malade, Mafanisana a cherché de l’aide – mais la première solution qui s’est présentée à elle n’aurait rien résolu. Un guérisseur traditionnel lui a demandé de lui donner une chèvre en échange d’un exorcisme visant à chasser un « mauvais esprit ».
Elle admet aujourd’hui qu’elle a failli céder à cette escroquerie, mais c’est un message diffusé sur Radio Miramar qui l’a convaincue de changer d’avis. En entendant l’appel aux mères leur rappelant l’importance des vaccinations, elle a suivi le conseil et s’est rendue dans un centre de santé.
Les infirmières de l’hôpital universitaire Eduardo Mondlane, à Maputo, ont immédiatement pris en charge son fils et veillé à ce qu’il reçoive toutes les doses de vaccin nécessaires.
« Aujourd’hui, c’est un jeune garçon en pleine santé. La radio lui a sauvé la vie », affirme-t-elle.
Pour aller plus loin
S’appuyer sur les bonnes sources
L’une des priorités de la formation des animateurs et présentateurs de Radio Moçambique est de leur rappeler que seules l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère mozambicain de la Santé doivent être considérés comme des sources d’autorité pour les informations sur les épidémies, le séquençage génomique, la surveillance et les données de vaccination contre la polio et d’autres maladies, explique Fainos de Souza, responsable de l’évaluation des impacts à l’ICS.
« Nous ne voulons pas que nos présentateurs relaient eux-mêmes des rumeurs ou des théories du complot », souligne-t-il.
Avec son immense littoral, le plus long d’Afrique, le Mozambique est un territoire complexe pour les équipes de vaccination. Certaines régions sont particulièrement difficiles d’accès en raison de conflits localisés, de tempêtes récurrentes liées au changement climatique et du manque d’infrastructures.
Assurer une diffusion équitable des messages radio sur les maladies nécessitant la vaccination, comme la polio, reste un défi au Mozambique. Dans la province septentrionale de Cabo Delgado, des insurgés s’attaquent régulièrement aux équipements radio. Dans la province de Sofala, frappée par des inondations, les cyclones déplacent chaque année des centaines de milliers de personnes et endommagent les satellites de transmission.
Cette situation maintient Carlos Trindade Caomba, directeur de l’Engagement communautaire au ministère mozambicain de la Santé, en état d’alerte. Son ministère veille à ce que, où qu’un cyclone ou un conflit frappe, les équipements radio essentiels soient réparés en priorité, parallèlement aux interventions d’urgence telles que la distribution de nourriture et d’eau.
« La continuité des émissions de radio en accès libre est essentielle, non seulement pour la vaccination contre la polio, mais aussi pour lutter contre d’autres maladies préoccupantes comme le paludisme, le VIH ou le choléra », souligne-t-il.
« C’est une chaîne d’information formidable : des experts médicaux aux animateurs radio, jusqu’aux oreilles des mères de jeunes enfants », ajoute-t-il.
Grâce à la radio, la couverture vaccinale contre la polio au Mozambique a progressé de manière significative, atteignant 86 % en 2023, contre 81 % en 2019.
Des mères comme Chido Dliwayo en demandent encore plus. Elles aimeraient entendre les voix familières de « Radio Polio » aussi sur les réseaux sociaux.
« Certaines jeunes mères avec qui je discute à Matola disent que la radio, c’est dépassé. Le public migre vers WhatsApp. Suivez-les, ne les perdez pas », conseille-t-elle.
Davantage de Winile Ximba
Recommandé pour vous