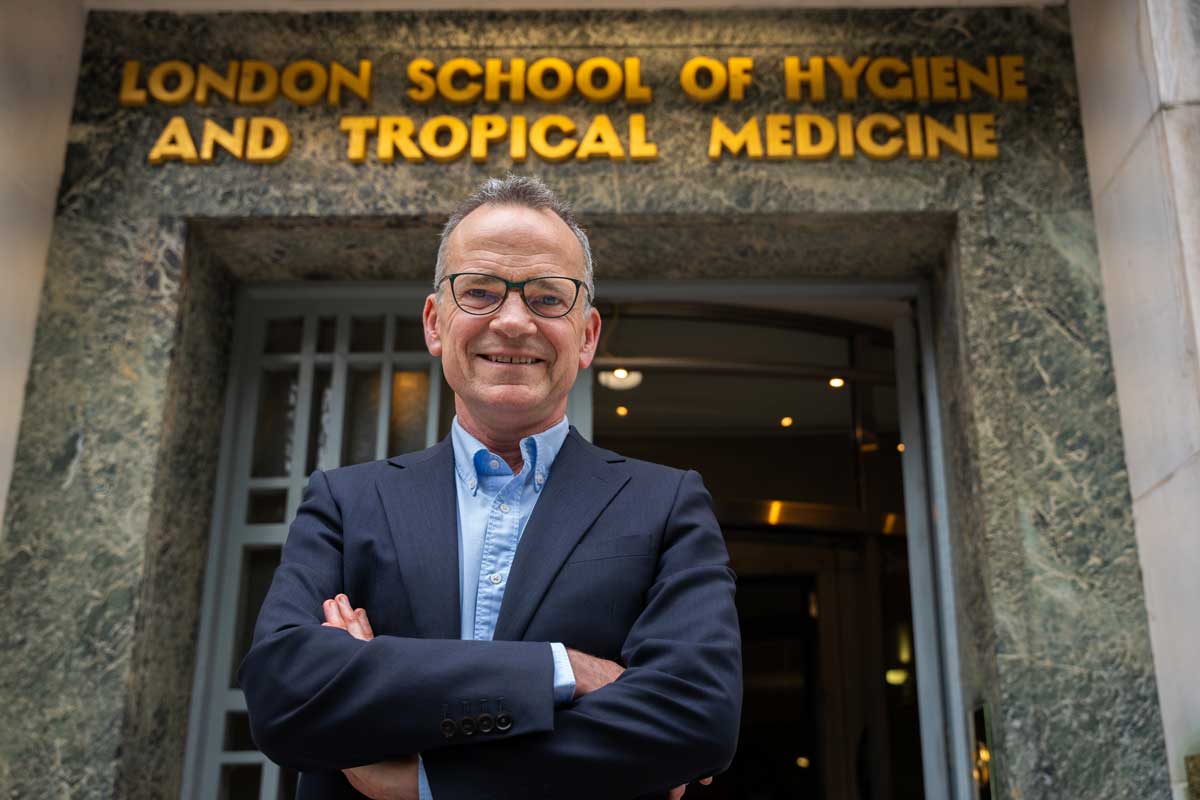Chikungunya : où en est la course au vaccin ?
Le chikungunya expose plus de personnes au risque que jamais auparavant. Esther Nakkazi a interrogé les médecins, fabricants de vaccins et épidémiologistes en première ligne de la riposte.
- 20 février 2025
- 7 min de lecture
- par Esther Nakkazi

Alex Almuedo est médecin senior et chercheur à l’Institut de Santé Globale de Barcelone (ISGLOBAL), ainsi que spécialiste en santé internationale à l’Hospital Clínic. En pleine saison touristique, sa clinique accueille jusqu’à 200 personnes par jour, qu’elles partent en vacances ou, dans le cas de nombreux membres de la communauté immigrée de Barcelone, qu’elles s’apprêtent à rendre visite à leur famille — souvent en Amérique latine.
Au retour des voyages, la clinique voit passer entre 30 et 40 patients, dont beaucoup ont attrapé l’une des fameuses maladies transmises par les moustiques de la région : dengue, zika ou chikungunya. « Le plus compliqué pour nous, c’est parfois de faire la différence entre ces trois maladies », explique Almuedo.
Les « trois grandes » maladies
La première étape consiste à écarter le paludisme. « Mais ensuite, ça se complique, car distinguer la dengue, le zika et le chikungunya n’est pas toujours évident », explique Almuedo. Selon lui, bien que la fièvre et les éruptions cutanées soient courantes dans les trois maladies, un symptôme en particulier attire l’attention.
« Si le patient souffre de fortes douleurs articulaires – ce qu’on appelle l’arthralgie – avec peu de douleurs musculaires mais des articulations enflammées, alors un déclic se fait et on se dit : “Ah, ça pourrait être le chikungunya” », précise-t-il. Parfois, ajoute-t-il, ces douleurs articulaires sont si intenses que les patients ont du mal à marcher.
Confirmer un diagnostic repose sur l’accès aux technologies. « Dans notre clinique, ce n’est pas un problème, car nous pouvons réaliser des tests PCR pour confirmer le chikungunya. Mais dans les endroits où les outils de diagnostic manquent, c’est un vrai défi. »
L’année 2024 a par ailleurs connu une forte augmentation des cas. « Je me souviens que l’an dernier, nous avons vu de nombreux patients revenir du Paraguay avec le chikungunya », raconte Almuedo. « Le problème, c’est qu’il y a constamment des foyers épidémiques. »
« Chaque année, différents pays d’Amérique latine sont touchés, et en ce moment, le plus grand nombre de cas de chikungunya se trouve au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Bolivie », poursuit-il. En 2024, le Brésil a enregistré 420 139 cas de chikungunya et 236 décès liés au virus.
« Les co-infections sont possibles »
Les tests PCR ne servent pas uniquement à confirmer un diagnostic suspecté, ils permettent aussi d’écarter les co-infections, rares mais possibles. « Il est particulièrement important d’exclure la dengue », souligne Almuedo. « Si vous traitez un chikungunya en phase aiguë, vous utiliserez probablement des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Mais en cas de dengue, on déconseille fortement les AINS en raison des risques liés aux plaquettes et des complications hémorragiques. »
« C’est donc essentiel de poser le bon diagnostic », insiste-t-il, « car l’approche thérapeutique change selon le virus en cause. » Malheureusement, il n’existe actuellement aucun test rapide largement disponible pour détecter le chikungunya.
Attendre trop longtemps rend aussi le test PCR moins pertinent. « Après les deux premières semaines d’infection, on se tourne vers la sérologie », explique-t-il. « La sérologie permet de détecter les anticorps produits par l’organisme en réponse au virus ou à la bactérie. Il existe deux types d’anticorps : les IgM, présents lors de la phase aiguë, et les anticorps chroniques, qui persistent plus longtemps et contribuent à la protection. Ce n’est pas le cas pour toutes les maladies, mais dans le cas du chikungunya, ces anticorps chroniques peuvent offrir une certaine protection. »
« Nous avons découvert une prévalence très élevée : environ 13 % des enfants présentant de la fièvre étaient infectés par le virus du chikungunya. »
- Professeur George Warimwe, vaccinologiste
« Ce que nous voulons vraiment, c’est un vaccin »
Renforcer son système immunitaire par une infection naturelle reste un pari risqué, d’autant plus que le chikungunya est une maladie aux effets persistants.
Lorsque les patients entrent dans la « phase chronique » du chikungunya, cela dépasse les compétences d’Almuedo. « Nous collaborons souvent avec des rhumatologues et, parfois, nous devons réaliser des échographies pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des articulations », explique-t-il.
Il n’existe aucun antiviral spécifique et efficace contre le chikungunya. Faute de traitement infaillible, un vaccin reste essentiel, souligne Almuedo. « Ce que nous voulons vraiment, c’est un vaccin qui offre une protection rapide, durable et, dans l’idéal, administré en une seule dose. Il devrait aussi couvrir plusieurs souches du virus, car il existe au moins quatre souches différentes de chikungunya. »
Rendre le vaccin accessible aux populations à risque
Bonne nouvelle : plusieurs vaccins contre le chikungunya sont en cours de développement, et certains sont déjà prêts à être déployés. Le laboratoire pharmaceutique Bavarian Nordic a obtenu l’approbation de la FDA pour son vaccin, et le produit de Valneva, baptisé IXCHIQ, est désormais disponible dans de nombreux pays.
IXCHIQ est un vaccin monodose contre le chikungunya qui devrait offrir une protection de cinq ans. Il a été autorisé aux États-Unis au début de l’année 2024, puis dans l’Union européenne à la mi-2023, avant d’être approuvé par l’agence britannique plus tôt ce mois-ci.
Mais pour que ce vaccin ne soit pas réservé aux seuls voyageurs, il doit être accessible aux populations des pays les plus exposés au virus. Pour y parvenir, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a annoncé en juillet 2024 un engagement de 41,3 millions de dollars pour soutenir un « accès élargi » au vaccin de Valneva – autrement dit, pour s’assurer qu’il soit disponible dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, comme le Brésil.
L’obtention d’autorisations réglementaires est l’un des leviers pour y parvenir. Bien que le vaccin n’ait pas encore reçu la préqualification de l’OMS, Thomas Lingelbach, PDG de Valneva, a confirmé fin 2023 que le processus était « en cours » et avançait parallèlement aux démarches d’approbation au Brésil.
Un autre enjeu majeur est le prix du vaccin. « L’objectif de Valneva est d’assurer un accès mondial à ce vaccin », a déclaré Lingelbach, soulignant que son entreprise met l’accent sur l’accessibilité financière.
Mieux comprendre la charge virale
Avant que le comité SAGE de l'OMS ne puisse recommander une utilisation plus large du vaccin, davantage de données doivent être collectées, comme l'explique la Dre Gabrielle Breugelmans, directrice de l'épidémiologie et des sciences des données au sein de la CEPI.
Si l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin ont déjà été bien établies, les recherches permettant d’évaluer le besoin réel et l’impact potentiel d’IXCHIQ – ou d’un vaccin similaire – sont encore en cours.
« Il est crucial de mieux comprendre la charge du chikungunya », souligne Breugelmans. « Il faut savoir, par exemple, quels sont les groupes les plus à risque d’infection, car avec ces données, nous pourrions concevoir des stratégies de prévention plus efficaces grâce au vaccin. »
Un vaste projet financé par la CEPI, intitulé ACHIEVE (Accelerating Chikungunya burden Estimation to inform Vaccine Evaluation), travaille justement à recueillir ces informations essentielles.
Pour aller plus loin
En première ligne de la recherche
Le Dr George Warimwe, du KEMRI Wellcome Trust au Kenya et professeur de vaccinologie à l’Université d’Oxford, dirige l’étude ACHIEVE. Son intérêt pour le chikungunya est né d’un détour inattendu. « Nous cherchions des cas de zika sur la côte kényane, dans une région appelée Kilifi, mais nous n’en avons pas trouvé. En revanche, nous avons observé de nombreux symptômes similaires à ceux rapportés au Brésil. À partir de là, nous avons décidé d’élargir nos recherches à d’autres arbovirus. Nous venions justement de mettre en place un laboratoire dédié aux arbovirus sur la côte kényane, et nous avons choisi de commencer par le chikungunya — naturellement, puisque le virus a été découvert en Tanzanie dans les années 1950, et que le Kenya est tout proche », raconte-t-il.
L’équipe a d’abord étudié la prévalence de la maladie en exploitant un ensemble d’échantillons prélevés lors d’une étude sur le paludisme. Ces échantillons provenaient d’enfants ayant consulté dans des centres de soins primaires pour des épisodes fébriles sur une période de cinq ans. Conservés dans une biobanque, ils ont pu être testés pour le chikungunya.
« Nous avons découvert une prévalence très élevée : environ 13 % des enfants présentant de la fièvre étaient infectés par le virus du chikungunya », explique Warimwe.
L’étape suivante visait à comprendre si ces infections provoquaient des formes graves. « Nous sommes retournés dans notre biobanque pour analyser des échantillons prélevés sur la même période, mais cette fois en nous concentrant sur les complications neurologiques graves, comme celles déjà documentées en Asie et en Inde. Nous avons observé qu’environ 10 % des enfants hospitalisés pour des maladies neurologiques présentaient des troubles de la conscience liés à une infection par le chikungunya », poursuit-il.
Cette découverte a été un choc. « Ce qui nous a vraiment surpris, c’est que, contrairement à d’autres régions du monde comme l’Asie ou l’Amérique du Sud, la charge virale semblait particulièrement élevée chez les très jeunes enfants — y compris les nouveau-nés. Cela suggère que certaines infections pourraient survenir dès la grossesse », souligne Warimwe.
Face à ces résultats, l’équipe a entamé des discussions avec la CEPI pour évaluer si ces observations pouvaient s’appliquer à l’ensemble de la région. « Si ces tendances se confirment ailleurs, cela aura des implications majeures pour le développement de stratégies d’intervention », affirme-t-il.
Les chercheurs ne se contentent pas de prouver l’utilité d’un vaccin ; ils cherchent aussi à savoir pour qui il serait le plus efficace. « Est-ce que les enfants bénéficieraient le plus de la vaccination ? Ou l’impact serait-il plus important chez les adultes ? »
L’étude ACHIEVE a ainsi pour but de cartographier la distribution du chikungunya en Afrique de l’Est et de vérifier si les observations faites sur la côte kényane se retrouvent ailleurs, notamment dans d’autres parties du Kenya et en Tanzanie. « L’objectif est de générer des données solides pour orienter le développement et le déploiement des futures interventions », conclut Warimwe.
Mais même avec un vaccin performant, le Dr Almuedo rappelle que cela ne suffira pas à éliminer la menace. « Le vrai défi reste la prévention des piqûres de moustiques », insiste-t-il. « Nous n’avons pas encore de vaccin pour tout le monde, donc les mesures de prévention restent essentielles. »
Davantage de Esther Nakkazi
Recommandé pour vous